L’art numérique : la révolution des « crypto-arts » ou non-fungible tokens (NFT)
- Thomas P. Hossen
- 2 févr. 2022
- 8 min de lecture
L’histoire de l’art s’est construite autour d’une dialectique entre déconstruction et reconstruction. Ainsi, on retient essentiellement des Grecs et des Romains leurs sculptures. Or la sculpture, c’est avant le contact à la matière et sa transformation tridimensionnelle. Le primat de plus en plus important de la peinture sur la sculpture change alors la donne. Certes, il y a toujours eu des peintres même dans la Grèce et la Rome antique, mais le privilège de l’artiste restait toutefois l’apanage du sculpteur. À partir du Moyen-Âge, les sculptures sont en effet moins présentes, pour une question de coût et de difficulté de travail de la matière. L’art religieux, qui a le primat de l’art dans le Moyen-Âge occidental et la Renaissance, dispose en effet de davantage d’atomes crochus avec la peinture qu’avec la sculpture : ornement des murs des églises, vitraux… La tridimensionnalité prend de l’espace dans les immenses « maisons de Dieu », toujours plus imposantes, toujours plus majestueuses, que les artisans de l’époque construisent — c’est durant cette périodes qui jaillissent du sol les cathédrales gothiques. Même dans l’art séculaire, c'est-à-dire l'art qui n'a pas trait au sacré, avec les natures mortes et les scènes de vie, ce sont surtout les peintres que l’on retient plus que les sculpteurs : Hans Holbein, Vermeer, Rembrandt… Des noms qui ont davantage traversé les siècles que les sculpteurs de l’époque. Même les sculpteurs de renoms de la Renaissance, Léonard de Vinci et Michel-Ange aux premiers chefs, sont avant tout connus pour leurs vermeilles picturales (La Joconde de Léonard, le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange) que pour leurs sculptures, si majestueuses soient-elles — du moins pour le grand public ; les commanditaires et autres nobles portant toujours dans leur cœur l’art de la sculpture.
Mais une interrogation apparaît avec ce passage du primat de la sculpture à celui de la peinture. La peinture transfigure certes la toile, mais cette dernière demeure ontologiquement limitée par l’absence de tridimensionnalité : peindre, c’est devoir composer avec cette limite structurelle de la toile. Les peintres sacrés du Moyen-Âge compensaient d’une certaine façon cette perte par une surenchère de matériaux précieux : auréoles en feuilles d’or, robes en lapis-lazuli… Bien évidemment, ce n’est pas la seule raison à invoquer : dans une cathédrale gothique, l’enjeu est d’orner de la manière la plus grandiose, à la limite du pompeux, pour faire honneur à Dieu. Mais peut-être pourrait-on se permettre d’imaginer que, si les peintures sur les vitraux étaient plus réalistes, ce « kitsch » eût été moins prononcé. Quoi qu’il en soit, le passage progressif du primat de la sculpture à la peinture à partir du Moyen-Âge témoigne d’une logique de déconstruction, et plus spécifiquement de perte de la tridimensionnalité. Et comme l’art a horreur du vide — pour paraphraser Aristote —, un besoin de reconstruction se fait sentir, qui se concrétise à la Renaissance par l’arrivée de la perspective dont la première œuvre qui l’utilise est attribuée à Donatello, peinte du début du quinzième siècle. L’arrivée de la perspective marque alors une reconstruction de la trimensionnalité, une recréation — fictive certes, projective plus exactement — de la profondeur : on « touchait » la profondeur avec la sculpture ; on la « ressent » désormais avec la perspective. C’est donc une reconstruction qui passe par une abstraction, une conceptualisation. Pendant quelques siècles, jusqu’à la Révolution industrielle presque, on peut dire que les techniques picturales se sont normalisées, avec çà et là quelques innovations — le sfumato sublimé par Léonard, la technique du clair-obscur chère aux peintres de la Renaissance… — mais toujours en gardant cette constance de retranscrire la profondeur grâce à la perspective.
Mais l’histoire de l’art, à l’instar de la grande Histoire, évolue par à-coups dont « l’avant-garde » est à la source. Le concept d’avant-garde ; tout un monde : le fait de s’éloigner des techniques « officiellement » reconnues, c’est en effet prendre le risque de l’ostracisme. Nul ne sait si l’original d’aujourd’hui tombera dans les oubliettes de l’Histoire ou deviendra le classique des décennies à venir. Que penser ainsi des œuvres de Monet ou de Manet, relégués sous le règne de Napoléon III au « Salon des refusés » (1863), comme pour indiquer qu’ils n’avaient pas leur place dans l’art, mais ne donnaient que la vague « impression » d’être artistes — n’oublions pas que le terme « impressionniste » fut initialement utilisé péjorativement par les contempteurs de Monet. Mais, en prenant du recul, comment analyser le « choc impressionniste » ? N’est-ce pas là une déconstruction dont l’avant-garde a le secret ? En effet, d’une certaine façon, l’impressionnisme sonne le glas de l’unité picturale de l’œuvre. La toile impressionniste n’utilise plus d’aplats de couleur, elle est construite à partir de points de couleur qui, mis bout à bout, ne font pas sens… à moins que l’on prenne du recul. Là intervient la logique de reconstruction : avec la perspective, l’unité de l’œuvre était restaurée ; avec l’impression, c’est à nous, observateurs, de restaurer l’unité de la toile en prenant le recul nécessaire pour que l’œil la perçoive. Cette reconstruction est donc une nouvelle couche d’abstraction : elle nécessite le recul, la collaboration de l’observateur qui, lui-même, restaure l’œuvre dans son esprit. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, on peut ainsi dire que c’est ce besoin de restaurer cognitivement l’unité de l’œuvre qui a animé l’histoire de l’art. Par exemple, c’est à nous d’imaginer la multiplicité des points de vue qui ont permis de peindre Guernica ; avec Picasso, un même visage est peint de dos, de face, de profil… C’est à nous d’imaginer les multiples points de vue pour reconstruire l’unité du visage déconstruit par la multiplicité des focalisations. Autrement dit, c’est nous qui sommes les « reconstructeurs » de points de vue « déconstruits » par leur multiplicité.
Mais si c’est à nous de restaurer l’unité de l’œuvre, on peut légitimement subodorer qu’il n’y a pas qu’une seule façon de percevoir l’unité de l’œuvre. La toile, certes unique — s’il y a une série de nymphéas, chacun des Nymphéas de Monet est unique — peut donc être perçue de façon différente. C’est ce qui sème les graines de la remise en cause de l’unicité même de l’œuvre. En effet, par la suite, l’œuvre qui était unique, perd de son unicité ; et c’est l’arrivée du pop art qui vient sonner le glas de l’unicité de l’œuvre. Monet en avait semé les graines ; Andy Warhol en récolte les fruits : on passe d’une œuvre matériellement unique, déjà multiple dans l’esprit des observateurs, à des œuvres véritablement sérielles : Andy Warhol a créé une véritable industrie de l’art, dont les contempteurs ont fustigé l’aspect « art-artisanat » et la déconstruction de l’unicité de l’œuvre. C’est un malaise dans l’histoire de l’art qui ne semble toujours pas résolu aujourd’hui. N’oublions pas cependant que le pop art a émergé il y a à peine soixante ans : c’est peu dans l’histoire de l’art. L’avant-garde met du temps à devenir le classicisme ; Van Gogh n’est-il mort ruiné alors que le prix de ses toiles frôle le milliard de dollars ? Aujourd’hui encore, on cherche à reconstruire le malaise provoqué par l’art contemporain. On se dit que, certes, on est passé à un art sériel, mais l’art contemporain n’est pas un artisanat au sens où sa source demeure toujours le génie, l’idée qui a participé de sa création. Voilà pourquoi les « chiens-ballons » signés Jeff Koons sont vendus plusieurs millions de dollars tandis que ses copies sur AliExpress — au demeurant identiques dans leur forme voire dans leurs matériaux — sont vendus pour moins d’un millier d’euros. Koons est le premier à avoir eu l’idée du chien-ballon ; c’est à lui que revient le primat du génie et ses copieurs ne sont que de pâles contrefacteurs. L’argument du génie permet ainsi de reconstruire d’une certaine manière l’unicité perdue de l’œuvre d’art sérielle : certes, l’œuvre est déclinée en plusieurs exemplaires, mais elle est issue d’une seule et même idée, celle de l’artiste.
On voit là que la logique de déconstruction – reconstruction aboutit à toujours plus d’abstraction : l’art devient une idée pure. Et cela n’est pas sans accentuer le malaise : que penser de la banane scotchée au mur de l’artiste italien Maurizio Cattelan, vendue pour 120 000 euros en 2019 ? Certes, Cattelan est le premier à avoir pensé à utiliser la banane scotchée au mur et d’appeler cette réalisation « art » ; c’est sa touche de génie, c’est lui qui a le primat de l’idée. C’est un mouvement qui date de près d’un siècle : Marcel Duchamp en 1919 avait nommé Fontaine un urinoir qu’il avait présenté comme œuvre d’art. L’idée de faire de l’art avec les objets du quotidien n’est donc pas nouvelle. Mais le problème soulevé par l’œuvre de Cattelan est nouveau dans le sens où il déconstruit la notion de permanence de l’objet : l’urinoir de Duchamp, la Marilyn de Warhol, si l’on veille à les conserver dans un endroit protégé, ils pourront résister à l’épreuve du temps. Mais la banane, elle, finira nécessairement par pourrir. Alors que faire ? L’art n’est donc plus lié à une logique matérielle, mais à une idée pure. C’est là le grand malaise de l’art contemporain : l’art devient matériellement éphémère, seule son idée pure traverse le temps. D’ailleurs, de façon cocasse, un certificat de Cattelan autorise l’heureux propriétaire de sa banane à remplacer cette dernière au besoin sans que cela n’altère l’originalité de l’œuvre. L’art devient concept pur, idée pure. C’est là une lecture bien hégélienne de l’histoire de l’art : peu à peu, l’art s’est détaché de la matière pour devenir un pur concept ; le génie ne se concrétise plus dans la production finale mais dès l’idée de création.
Et cette fin de la matérialité, aboutissement logique du processus de déconstruction orchestré par les artistes contemporains, crée un malaise : si l’art devient idée pure, comment le posséder, comment s’assurer qu’il n’y a pas de contrefaçons, comment prouver qu’on est le premier à avoir eu « l’idée de génie » ? C’est là que la blockchain vient, peut-être proposer une logique de reconstruction pour mettre fin au malaise contemporain dans l’art. En effet, si l’art devient idée pure, totalement détachée de sa matérialité qui pourtant le caractérisait depuis les premières œuvres des hommes préhistoriques sur leurs grottes jusqu’à l’aube du troisième millénaire, n’est-ce pas finalement logique que l’art devienne numérique et qu’il ne soit que des 0 et des 1 traités par une machine ? De nos jours, on comprend en effet de moins en moins que l’art ait besoin de support matériel. L’arrivée de l’art numérique, loin d’être une anomalie dans l’histoire de l’art, se lit plutôt comme l’aboutissement logique du processus de déconstruction de l’art contemporain dont il est même une proposition de reconstruction. En effet, comme nous allons l’étudier, la blockchain constitue un registre horodaté inviolable et infalsifiable. Aussi, l’arrivée de l’art numérique au travers des non-fungible tokens (NFT), en proposant un véritable certificat d’authenticité, vient résoudre le problème de la contrefaçon et permet au premier créateur de l’idée de prouver, via la blockchain, qu’il est bien le premier à avoir eu « l’idée de génie ». Les NFT poussent la logique hégélienne à son maximum, en faisant du certificat d’authenticité l’œuvre d’art, matériellement inexistante, immuable sur la blockchain. D’une certaine façon, les NFT résolvent le malaise contemporain de la mort de l’unicité de l’œuvre d’art.
Aujourd’hui, les NFT sont l’avant-garde, à l’instar des impressionnistes du Second Empire. À l’heure de l’internet où tout s’accélère, où l’avant-garde devient le classicisme non plus en cinquante ans mais en un an, dans quelle mesure les NFT peuvent-ils se lire comme le renouveau, la reconstruction, la renaissance de l’art contemporain ? Loin d’être un hubris, un mouvement spéculatif ou une mode éphèmère, les NFT ne sont-ils pas en réalité le remède au malaise de l’art contemporain ?
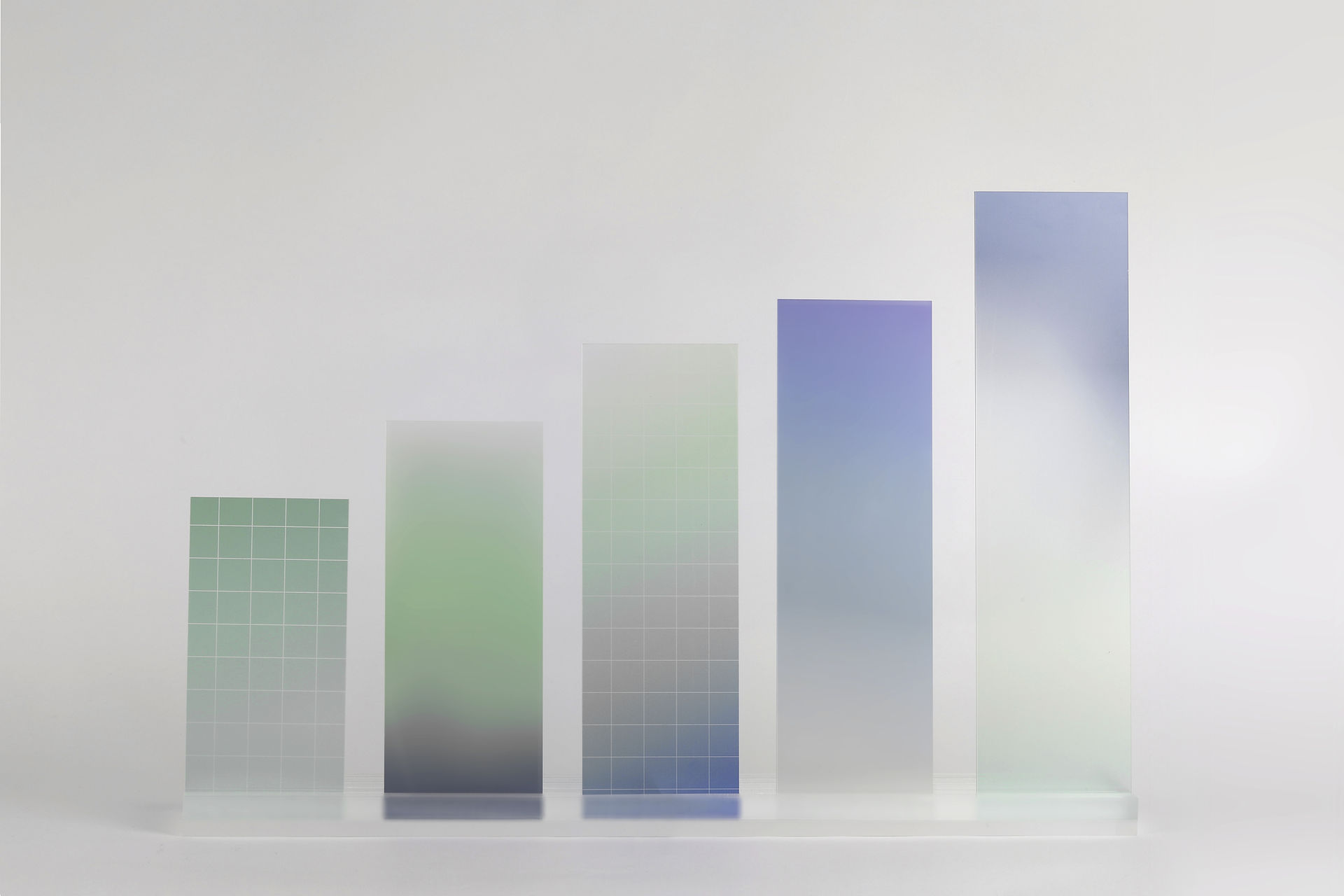
Commentaires